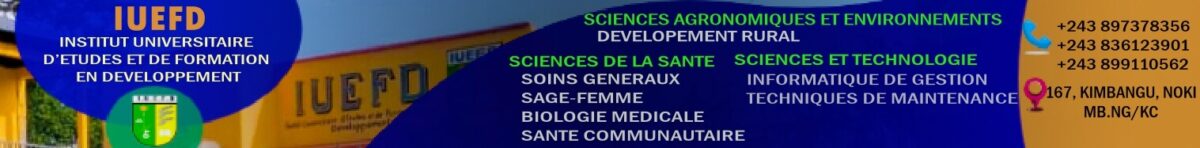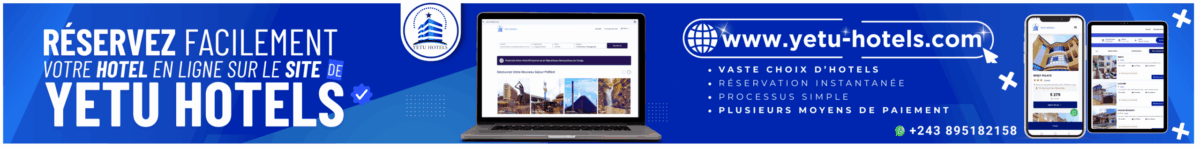Kasangulu, territoire du Kongo Central, tout proche de la capitale Kinshasa, vit une tragédie humaine passée presque sous silence. Les violentes pluies de fin avril et début mai ont plongé plusieurs quartiers, notamment Nsaya et Manoka à la gare, dans une détresse totale. Les habitants, démunis, ont trouvé refuge dans l’école primaire Mbolula, transformée en abri de fortune… au détriment des élèves désormais privés d’éducation.
Depuis des semaines, aucune aide concrète n’est arrivée. Les familles dorment à même le sol dans les salles de classe, sans eau potable, sans soins, sans espoir. Pendant ce temps, les élèves légitimes de l’école sont contraints de rester chez eux, exposés aux dangers de la rue, abandonnés par un système qui semble dépassé.
Pourtant, le territoire de Kasangulu n’est pas sans ressources : des élites locales siègent dans les institutions, des carrières minières existent, des entreprises opèrent. Mais face à cette urgence humanitaire, c’est le silence radio.
Vendredi 9 mai, l’Administrateur du territoire tente de rassembler les forces vives (églises, entreprises, ONG) autour d’une table pour envisager des actions de secours. Une initiative saluée, mais rapidement controversée : des voix s’élèvent pour dénoncer un appel à la solidarité jugé « imposé », les contributions étant perçues comme une obligation plutôt qu’un élan volontaire.
Le paradoxe est cruel dans une société où l’on prêche la compassion dans les églises à chaque sermon, la réalité du terrain montre un écart abyssal entre discours et action. Pourquoi est-il si difficile de venir en aide à ses semblables quand le besoin est si criant ? L’élan de solidarité mondiale pour d’autres pays frappés par des drames montre qu’une autre voie est possible. Mais à Kasangulu, il semble que l’on doive encore enseigner… ce qu’est la compassion.